 De Abderrhamane Sissako avec Ibrahim Ahmed dit Pino, Toulou Kiki et Abel Jafri
De Abderrhamane Sissako avec Ibrahim Ahmed dit Pino, Toulou Kiki et Abel Jafri
Au milieu du désert, une jeune femme hurle la mort, lacérée par de violents coups de fouet. Son crime ? Avoir chanté et offert sa sublime voix aux oreilles de tous. D’épaisses larmes roulent le long de ses joues et, bientôt, ses hurlements laissent place à une douce mélodie. L’image, d’une force inouïe, cristallise à elle-seule la toute-puissance de Timbuktu, le nouveau long métrage (citoyen) du mauritanien Abderrhamane Sissako. Elle illustre aussi la volonté première d’un cinéaste inspiré, au fait de son temps, qui a choisi de brandir sa caméra comme une arme et de tirer avec noblesse et dignité sur les nouveaux visages de l’obscurantisme en Afrique. Après l’inoubliable Bamako, c’est à Tombouctou que l’intéressé a choisi de nous conduire le temps d’un drame d’exception. La ville, située aux abords du fleuve Niger, est ici tenue d’une main de fer par des djihadistes belliqueux. Armés de kalachnikovs, ces derniers veillent au grain afin que personne ne succombe aux sirènes du péché (occidental). Aux quatre coins des rues, le silence triomphe donc, poisseux et vertigineux, et les habitants, apeurés ou stoïques, glissent telles des ombres errantes pour éviter un hypothétique écart de conduite. On aurait pu craindre une œuvre à charge manichéenne, larvée de leçons moralisatrices. Mais, fort heureusement, depuis les dunes chaudes du Sahel, Sissako observe avec une distance salutaire l’émergence du mal. A travers le parcours de ses personnages, dont Kidane, un père de famille ayant accidentellement tué un pêcheur, le réalisateur met en lumière l’opposition entre deux Islam. Celui de la tolérance et du modernisme contre celui de la violence perpétrée au nom d’Allah. Ce bras de fer qui s’opère de façon inattendue, dans une douceur éthérée. La force de Timbuktu réside justement dans ce contraste entre l’extrême cruauté des situations et la vénusté époustouflante des visages et des panoramas. Cet antagonisme donne naissance à des moments de pure poésie où se confondent le beau et l’absurde (à l’instar d’une séquence d’air football mémorable), la haine et l’amour, l’espoir et le désespoir. Mi conte, mi pamphlet, ce délicat obus cinématographique, porté par des plans somptueux, aurait dû recevoir un prix majeur à Cannes, où le jury l’a boudé de la manière la plus abjecte qui soit. Ne le manquez surtout pas. Vous en ressortirez sonnés et émus, notamment par la dernière image. Celle de l’enfance sacrifiée, bafouée, oubliée qui court, court, court, comme une bête traquée. Sans savoir où aller.
Mehdi Omaïs



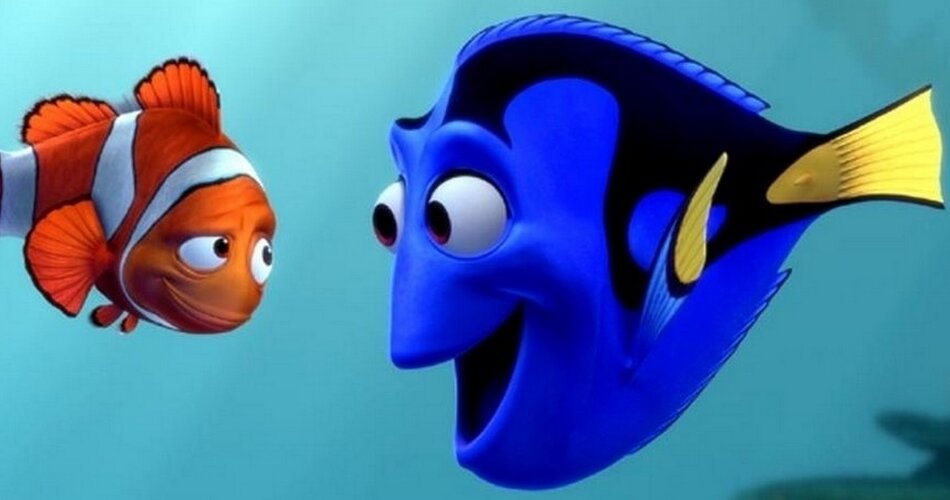












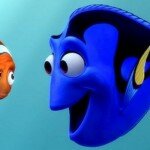
 2014 : une année très difficile pour Nicole Kidman
2014 : une année très difficile pour Nicole Kidman




Suivez les Cinévores